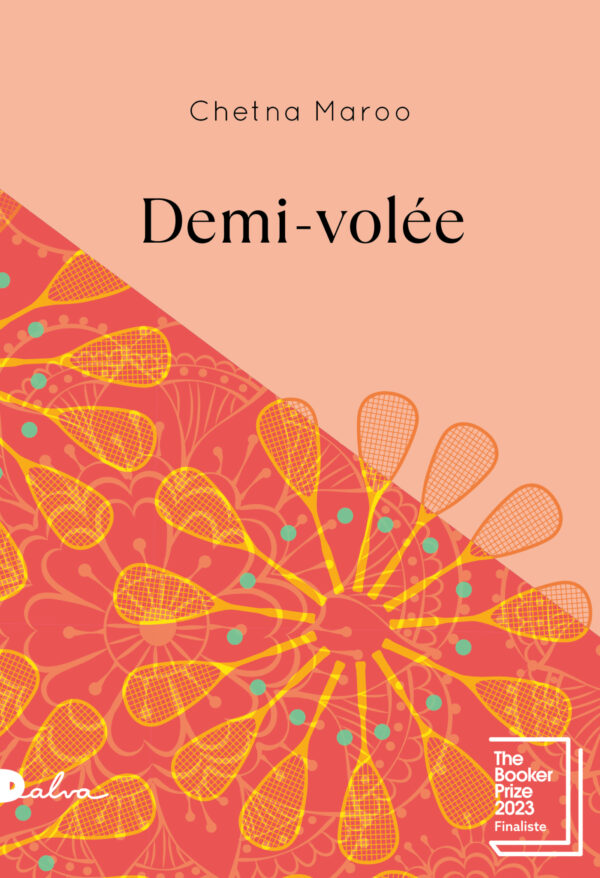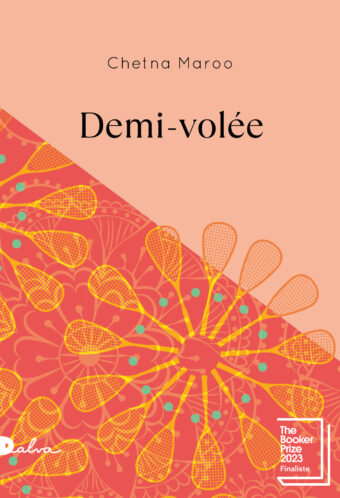
- Premier roman
- 21 € | 208 pages
- parution le 5 septembre 2024
- ISBN 978-2-4876-0001-0
Dans la banlieue de Londres, un père doit élever seul ses trois filles. La disparition de leur mère le laisse démuni : il faut cadrer ces adolescentes, les occuper, lui dit sa famille. C’est ainsi que la jeune Gopi, comme ses deux aînées, se retrouve sur les terrains de squash. Bientôt, l’univers de la jeune fille bascule : le sport devient son seul horizon et sa passion. Sur le terrain, elle n’est pas seule. Elle est avec son père. Elle est avec Ged, son jeune partenaire, elle est avec ses sœurs. Et la magie opère…
Finaliste des plus grands prix littéraires internationaux, le premier roman de Chetna Maroo nous fait vivre le passage à l’âge adulte d’une jeune femme qui trouve dans le dépassement d’elle-même le chemin qui la mène vers la liberté.

- Revue de presseDemi-volée conquiert le lecteur, à mille lieu de s'imaginer au départ qu'il se passionnerait de décrypter un jeu qui le dépasse. Mais puisque la vie humaine et la tendresse s'y déploient, on s'éprend. La primo-romancière se fait une place dans notre bibliothèque avec cette histoire simple, humaine et fatalement poignante.Chetna Maroo évoque le deuil, l'amour, le poids des origines, l'espoir, les renoncements, la sororité avec une subtilité étourdissante.Ce premier roman finaliste du Booker Prize est à lire absolument, peu importe que l'on connaisse les règles du squash ou pas, l'émotion ressentie est intacte.
- Quelle finesse, quelle profondeur, que de sentiments exprimés par petites touches. Merveilleux.L'histoire de cette famille est très forte, l'amour qui transparaît sans jamais être étalé, la pudeur des sentiments, la douceur et la complexité des relations, les émotions que l'on perçoit sans vraiment réussir à les identifier… Un très beau roman !Chetna Maroo parle du deuil avec finesse et subtilité et nous offre un premier roman original et touchant.
- Un
Je ne sais pas s’il vous est déjà arrivé de vous planter au milieu d’un court de squash – pile sur le T – et d’écouter ce qui se passe sur le court voisin. Je pense au bruit qui provient du terrain d’à côté, celui que fait une balle frappée net et fort. Un son rapide et assourdi, semblable à une déflagration, suivi d’un écho très proche. Cet écho, l’écho de la balle qui cogne le mur, résonne plus que le choc d’origine. C’est cela que j’entends lorsque je me remémore l’année qui suivit le décès de notre mère, l’année où notre père nous emmenait à Western Lane pour que nous nous y entraînions deux, trois, quatre heures par jour. La première fois que j’ai remarqué ce bruit, ce devait être un soir après l’école. Je ne sentais plus mes jambes, j’étais certaine que j’allais déclarer forfait et je me tenais simplement sur le T avec ma raquette, la tête basse et les yeux fixés sur les traces à peine visibles laissées par les balles qui avaient rasé la surface du mur. J’étais censée servir, mon père devait répondre par un revers et moi par une reprise de volée, il y aurait ensuite un autre revers et une autre volée qui prendrait pour cible la ligne de service rouge sur le mur frontal. Debout au fond du court, loin, mon père attendait. À son silence j’ai deviné qu’il n’allait pas prendre les devants et que je ne pouvais que servir et volleyer, ou sinon le décevoir. Les barbouillis sur la paroi se confondirent et je me suis dit que forcément, j’allais tomber. Le bruit se fit entendre à cet instant. Un rythme régulier, mélancolique, en provenance du court voisin, le coup puis son écho, infatigablement répété, comme une forme de délivrance. J’ai deviné qu’il s’agissait de quelqu’un qui répétait ses automatismes. Et je savais qui. Je suis restée sans bouger, l’oreille tendue, et le son s’est déversé en moi, dans mes os et dans mes nerfs, j’ai levé ma raquette et frappé la balle avec la sensation d’avoir été tirée d’affaire.
Nous étions trois, trois filles. Quand Maman est morte j’avais onze ans, Khush en avait treize, Mona quinze. Nous jouions au squash et au badminton deux fois par semaine depuis que nous étions en âge de tenir une raquette, mais ce n’était rien par rapport à ce qui allait suivre. D’après Mona, le travail sur la vitesse, le ghosting et les séances intensives de trois heures, tout cela commença le jour où Ranjan, notre tante, avait affirmé qu’il nous fallait de l’exercice et de la discipline, et Papa était resté assis sans rien dire et il l’avait laissée parler.
Nous étions là, avec eux, dans sa cuisine, et nous l’avons entendue. Mona lavait des pommes de terre dans l’évier. La tête inclinée et les manches retroussées jusqu’au coude, parce qu’elle ne se contentait pas de les passer sous l’eau. Elle grattait vraiment la terre. Sa queue-de-cheval se balançait par-dessus son épaule. Khush épluchait avec des gestes lents tout en regardant par la fenêtre. Moi, installée à la table, j’épépinais des grenades. Tante Ranjan avait réprimandé Khush parce qu’elle avait les cheveux détachés, ensuite elle s’était tournée vers moi, elle avait replié la moitié de la nappe blanche et elle avait étalé des journaux pour éviter que je mette du jus sur ses meubles tout neufs. Des meubles magnifiques, cirés et foncés.
De là où j’étais assise, j’arrivais à voir le gulab jamun qu’elle avait préparé tôt ce matin-là. Les boulettes de pâte spongieuse d’un or bruni étaient déjà imbibées de sirop et empilées généreusement dans un saladier en verre au bout de la desserte.
Tante Ranjan me prit en flagrant délit.
— Gopi, lança-t-elle.
Je me suis figée et j’ai piqué un fard à la seconde où j’ai entendu mon nom.
Tante Ranjan se mit debout. Elle se positionna à un angle qui m’empêchait de voir le dessert. J’ignore pourquoi, mais il me parut important de garder les yeux braqués devant moi, de donner l’impression que je fixais le vide depuis le début.
— Une sauvageonne, répéta-t-elle, le regard toujours vissé sur moi, tout le monde le sait.
Alors elle se tourna vers Papa, et c’est vrai qu’il restait assis là, il ne voyait rien, ne parlait pas. Tante Ranjan attendit avant de reprendre la parole :
— Bon, j’ai dit ce que j’avais à dire. À toi de prendre ta décision.
Papa leva la tête pour étudier tante Ranjan quelques instants et il y avait au fond de ses yeux une froideur à laquelle nous étions habituées, nous, mais pas tante Ranjan. Elle est devenue toute rouge. Sur la gazinière
la cocotte-minute émit un sifflement strident et ténu, soudain la vapeur et l’odeur des lentilles trop cuites se répandirent dans la cuisine. Tante Ranjan s’épongea le front avec un torchon propre posé sur le dossier d’une chaise.
- Premier roman
- 21 € | 208 pages
- parution le 5 septembre 2024
- ISBN 978-2-4876-0001-0
- À la rame
- À Palmares
- Amour, extérieur nuit
- Après la brume
- Biographie sentimentale de l'huître
- Boa
- Carnet de phares
- Chimères tropicales
- Corregidora
- Erreur de jugement
- Guérisseuses
- Histoires passagères
- Je suis une île
- L'Enfant rivière
- L'étreinte des ombres
- L'Oiseau rare
- L’Octopus et moi
- La couvée
- La Dent dure
- La Ligne de couleur
- La Puissance cachée des plantes
- La Sauvagière
- Le délicieux professeur V.
- Le Monsieur
- Le Patriarcat des objets
- Les Animaux de ce pays
- Mer agitée
- Mes hommes
- Nourrices
- Philosophesses
- Pornografilles
- Pussypedia
- Tout le blanc du monde
- Tout le monde sait que ta mère est une sorcière
- Atmosphère
- L'Étrangère
- Pour une résistance oisive
- Trinity, Trinity, Trinity
- Voir tous nos livres